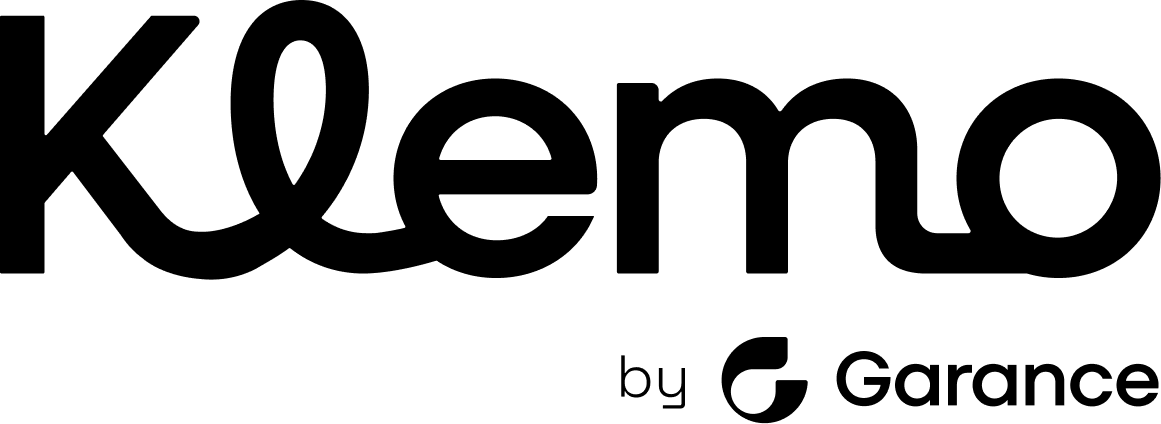1. Pourquoi l’argent reste tabou : héritages culturels et normes sociales
2. Les impacts du tabou financier sur la vie de couple
3. Comment lever le tabou et instaurer un dialogue fructueux
4. Conclusion
1. Pourquoi l’argent reste tabou : héritages culturels et normes sociales
Le silence autour de l’argent ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d’une histoire et de normes sociales qui façonnent nos comportements depuis des générations.
Héritages culturels et moraux
Le tabou autour de l’argent en France se comprend à travers la culture judéo-chrétienne, où il a longtemps été associé au vice, presque comme un péché, mais il est également profondément ancré dans l’histoire économique et sociale de l’Hexagone. La société française actuelle s’est en effet construite sur des valeurs d’égalitarisme et de solidarité : depuis la Révolution, la méfiance vis-à-vis des grandes fortunes et des privilèges hérités a nourri une vision parfois négative de l’enrichissement personnel.
Résultat, une mentalité pudique par rapport à ses revenus, même entre proches. Aujourd’hui encore, beaucoup souhaitent gagner plus mais hésitent à en parler ouvertement. Un sujet véritablement tabou pour 62 % des Français qui estiment qu’il est mal vu de parler de son salaire (IFOP 2022).
Une retenue culturelle qui va évidemment affecter les relations de couple : même exprimer un simple souhait d’épargne est chuchoté en secret afin de ne pas s’ébruiter dans Wisteria Lane.
Enfin, il est utile de rappeler que le modèle social français repose sur une forte intervention de l’État (retraite, protection sociale, fiscalité redistributive). De quoi entretenir l’idée (erronée) que les questions financières sont avant tout une affaire collective qu’une puissance intouchable gère au-dessus de nous. Parler d’argent devient presque un acte de transgression lorsqu’il va à l’encontre de cette culture de réserve et d’égalitarisme. Mais qu’en pensent les autres ?
Comparaisons culturelles
Dans certains pays, parler d’argent est naturel et valorisé. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, poser la question du salaire est un acte banal et pragmatique. Même son de cloche en Norvège, où les salaires peuvent être publics, favorisant transparence et équité. Imaginez le malaise si c’était le cas à la française ! Dans ces nations, les couples ont donc tendance à aborder très tôt les questions de finances communes, ce qui favorise logiquement une planification conjointe. Chacun sait combien son partenaire gagne, ce qui rend naturelle la construction de projets communs sur des bases réalistes et partagées.
Mais en Espagne ou en Italie, l’argent reste lié au paraître et aux traditions familiales, renforçant l’idée qu’il vaut mieux se taire. Ces cultures plus discrètes entraînent un retard dans les discussions de finances, générant des malentendus ou des tensions au moment de prendre des décisions importantes. Une enquête de YouGov en 2022 nous indique même que 43 % des Français n’ont jamais parlé de leurs revenus exacts avec leur partenaire avant d’emménager ensemble. Une différence culturelle qui peut alors avoir un effet domino :
- Cela influence le choix du modèle financier (comptes séparés / comptes communs).
- Cela conditionne la répartition des charges (implicite / négociée).
- Cela impacte la stabilité économique du couple.
Ces différences culturelles peuvent aussi poser problème au sein d’un couple mixte. Un Français discret sur ses finances peut sembler mystérieux à un partenaire habitué à plus de transparence, et inversement, un partenaire très ouvert peut paraître indiscret. Ces différences peuvent parfois créer des incompréhensions dans les couples mixtes et fragilisent leur organisation financière, avec des impacts concrets sur les bilans budgétaires, l’investissement ou le choix d’un compte commun.
Pour dépasser ces malentendus, mieux vaut développer une culture commune de l’argent. Le but ? Transformer les malentendus en complémentarités. Après tout, c’est comme ça que fonctionne l’allocation d’un produit d’épargne : un peu de prudence équilibre un placement audacieux.
Normes sociales et pression du jugement
Ah, le regard des autres ! Montrer un train de vie modeste peut être jugé pauvre, afficher un niveau de vie élevé peut passer pour de l’arrogance. Les réseaux sociaux ajoutent une couche de pression supplémentaire : des vies idéalisées et « Instagrammables » donnent parfois envie de tout cacher. Le silence devient alors un mécanisme de protection, même au sein du couple.
On a donc deux normes opposées : la valorisation de la réussite matérielle (bon salaire, propriétaire de son logement, épargne importante) et de l’autre une valorisation culturelle de la modestie et de l’égalité. Finalement, peu importe le niveau de vie affiché : on risque d’être jugé. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de réussite artificielle ou réelle créent un biais de comparaison sociale permanent. Le sentiment d’insuffisance, voire de honte, est alors amplifié, surtout chez les jeunes. Une étude IFOP illustre ce propos en indiquant que 62 % des 18-34 ans estiment que les réseaux sociaux augmentent la pression à réussir financièrement.
Mais Instagram et compagnie ne sont pas les seuls à exercer une pression. Les normes sociales genrées jouent également un rôle prépondérant en continuant d’associer certains rôles financiers aux genres. Vous les connaissez : moi, homme, gagne plus d’argent et aller chasser pour nourrir femme. Et si une femme a le malheur de gagner mieux sa vie que son conjoint, elles seront probablement taxées de carriéristes et leur conjoint d’adjectifs touchant à leur virilité.
Pire encore, d’après l’Insee, dans un couple hétérosexuel sur quatre où la femme gagne plus que l’homme, celle-ci assume tout de même une plus grande part des tâches domestiques. Un déséquilibre persistant.
Le couple comme espace d’évitement
Être avec sa moitié, c’est être dans un refuge face aux contraintes extérieures. L’argent, souvent source de stress, reste alors à la porte. Une mise à l’écart qu’on peut penser protectrice pour préserver l’amour de toute tension. Cependant, un paradoxe se créé : on partage un lit, des repas et des projets, mais chacun garde ses zones d’ombre. Certes, chacun a évidemment le droit de garder un jardin secret... tant qu’il n’impacte pas l’autre partenaire ! Entre dettes cachées, comptes secrets ou encore dépenses compulsives, la vérité financière reste cachée.
Des non-dits qui peuvent transformer une relation en jeu de devinettes. À long terme, cet évitement apaise les conflits. Mais à long terme, il installe une méfiance souterraine. Pour sortir de ce cercle, rien de tel qu’un pas de vulnérabilité. Se mettre à nu, dans un couple, est souvent plus difficile métaphoriquement que littéralement : oser dire combien on gagne, ce qu’on dépense et ce qu’on redoute. Poser cartes sur table pour, enfin, regarder ensemble dans la même direction et transformer un lieu d’évitement en espace de confiance.
Transmission familiale
Le silence se transmet souvent de génération en génération. Le comportement des parents sert de modèle implicite pour les enfants qui seront influencés dans leurs pratiques à l’âge adulte. Imiter ou aller à l’encontre de ses parents, tous les enfants devenus adultes y font face : le tabou de l’argent dans le couple n’est pas isolé, mais est le fruit d’une dynamique intergénérationnelle.
Ainsi, dans de nombreuses familles, parler d’argent avec les enfants est aussi inconfortable que de parler sexualité, par exemple. Les jeunes adultes arrivent en couple sans repères financiers, reproduisant inconsciemment les comportements de leurs parents. Ce cycle de non-communication alimente le tabou et les malentendus, compliquant encore plus les discussions dès le début de la vie commune.
Et lorsque ces enfants deviennent eux-mêmes parents, la question de l’éducation financière se pose. On transmet tout à son enfant, alors, pour briser le cycle du silence, peut-être est-il utile d’intégrer l’éducation financière dès le plus jeune âge. Cela ne fera peut-être pas d’eux des traders accomplis, mais cela pourrait les initier aux problématiques financières. Libre à eux d’en faire ce qu’ils voudront.
Avec les bons outils, parler d'argent devient naturel
2. Les impacts du tabou financier sur la vie de couple
Le silence autour de l’argent ne reste jamais sans effet. Il fragilise la confiance, alourdit la charge mentale et accentue les inégalités, surtout lorsque seule une personne prend en charge le budget.
Tensions et charge mentale
Pour la moitié des Français, l’argent est source de disputes régulières. Quand un seul partenaire gère le budget, l’autre se décharge de la responsabilité et celui qui s’en occupe peut rapidement se sentir submergé. Résultat, les oublis, les petites erreurs et les frustrations s’accumulent. Le stress lié aux finances, souvent silencieux, finit par peser sur la vie quotidienne et transforme de simples conversations sur les courses en véritables champs de bataille.
Une situation qui peut dégénérer en déséquilibre dans la charge mentale : la personne en charge du budget a en tête la planification des dépenses, le suivi des factures, l’anticipation des projets communs, etc., tandis que l’autre se contente de dépenser son argent en petits plaisirs.
Un poids psychologique bien réel qui peut aller jusqu’à affecter la qualité du sommeil, la confiance et la communication au sein du couple. Au début, partager les notes de restaurant semble simple et léger. Mais dès lors qu’on vit ensemble, que les enfants arrivent et qu’on parle de sommes plus élevées qu’un Uber Eats, les décisions financières se complexifient. Mais parler d’argent n’a pas à être synonyme de tensions, où chaque projet se transforme en bombe à retardement. Anticiper pour mieux régner, discuter pour mieux aimer.
Mésententes et inégalités invisibles
Dans la majorité des couples hétérosexuels, l’homme gagne plus que la femme. Si cette inégalité n’est jamais abordée, elle devient un terrain miné : qui paie quoi ? Qui épargne ? Qui décide ? Si la répartition des charges peut se faire implicitement en fonction du revenu, un déséquilibre naturel peut s’installer : la femme assume moins de responsabilités financières que l’homme, ce qui renforce une forme de domination économique. Je paye, donc je choisis.
Le silence face à cette dynamique du pouvoir peut évidemment entretenir des frustrations silencieuses, voire un sentiment d’injustice, même dans des couples aimants.
Pire, l’argent peut devenir un outil de domination ou de dissimulation et ainsi éroder la confiance au sein du couple. Une dynamique de contrôle silencieuse peut s’intensifier et se transformer en violences économiques. On prive le partenaire d’accès à l’argent, on contrôle tous les revenus, on distribue de l’argent de poche au compte-goutte... De quoi entrer dans une dépendance financière qui limite les libertés de choix et de mouvement.
La solution ? Plusieurs options peuvent vous aider à rétablir l’équité et instaurer un dialogue :
- Une mise en place d’une répartition des dépenses proportionnelle aux revenus (prorata),
- Un modèle mixte entre comptes communs et séparés pour clarifier les responsabilités,
- L'accompagnement par un conseiller financier,
- Les outils de suivi budgétaires partagés, etc.
Dépenses genrées au sein du couple
« Demande à ta mère. » Qui n’a jamais entendu cette injonction de la part de son père ? Autre dimension souvent invisible de l’inégalité financière dans les couples : les dépenses liées aux enfants. Oui, les femmes prennent majoritairement en charge le matériel scolaire, les vêtements, les rendez-vous médicaux ou encore les activités extrascolaires d’après l’Insee. Charge mentale, logistique importante... et frais supplémentaires.
En cas de séparation, l’asymétrie se renforce encore. Avec 80 % des enfants qui vivent avec leur mère, cette dernière a la charge d’assumer seule la majorité des coûts avec des pensions alimentaires versées jugées souvent insuffisantes. En 2021, l’Insee estimait un coût réel de 490 à 600 euros par mois et par enfant contre une pension de 190 euros en moyenne par enfant et par mois.
Ainsi, la gestion des frais liés aux enfants ne se limite pas à une question de revenus : elle traduit aussi une inégalité structurelle persistante. Une fois encore, une discussion ouverte de ces dépenses et une formalisation de leur répartition aideraient à clarifier les responsabilités et instaurer une répartition plus équitable.
Inégalités sociales et de genre
Historiquement, l’homme gérait les finances, et ce modèle persiste parfois. Aujourd’hui, si les deux partenaires des couples hétérosexuels travaillent généralement, les écarts de salaires entre femmes et hommes restent marqués et influencent directement les dynamiques financières dans le couple.
D’après l’Insee, en 2023, le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé est inférieur de 22,2 % à celui des hommes. Un chiffre qui s’explique notamment (mais pas que) par :
- Des différences de temps de travail (les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel que les hommes),
- Une ségrégation professionnelle (les femmes occupent plus souvent des postes moins rémunérés),
- Des interruptions de carrière liées à la maternité, etc.
Mais même lorsqu’on compare les revenus des femmes et des hommes à poste équivalent, dans la même entreprise, avec le même volume horaire, un écart inexpliqué persiste : environ 3,8 à 4 % en défaveur des femmes en 2023. Autrement dit, deux individus qui occupent le même emploi à temps plein et dans la même entreprise peuvent avoir une rémunération qui diffère en fonction de leur genre.
Attention, des nuances sont à connaître : ces chiffres concernent un emploi comparable dans le même établissement : certains écarts s’expliquent également par des différences de secteur, d’ancienneté, de responsabilité, de promotions, etc. En élargissant ce rapport à temps équivalent de travail, mais pas forcément à poste équivalent, cet écart grimpe à 14 % en 2023 pour les salariés du privé.
Cette inégalité a des effets en cascade sur la vie de couple : poids dans les décisions financières, honte d’exprimer son avis, mais aussi écarts d’épargne et de patrimoine. L’Insee rapporte en effet que les femmes disposent en moyenne d’un patrimoine inférieur de 9 % à celui des hommes.
Des écarts structurels qui peuvent aussi se transformer en situations plus graves encore avec une violence financière où un partenaire opère un contrôle abusif sur les revenus ou le patrimoine de l’autre. Confiscation du salaire, interdiction de dépenser librement son argent ou surveillance stricte des dépenses, tous ces abus existent réellement. Largement taboue, cette violence économique prive la personne concernée de son autonomie et freine logiquement l’indépendance, même après une séparation. Pour rappel, la dépendance financière est l’un des principaux facteurs qui empêchent de quitter une relation toxique ou abusive.
3. Comment lever le tabou et instaurer un dialogue fructueux
Bonne nouvelle : parler d’argent ne tue pas l’amour. Les couples qui abordent le sujet régulièrement posent des bases solides de confiance, renforcent l’équité et limitent les tensions. La communication permet d’avancer, mais surtout de penser ensemble. « Entre le plus possible dans l'âme de celui qui te parle », disait Marc-Aurèle.
Instaurer la transparence et des rituels financiers
Un conseil de couple mensuel, sans cravate ni tableau Excel (ou, au moins, mettez-y un peu de couleur !), permet de mettre à plat dépenses, projets et éventuelles dettes. Organiser un rendez-vous mensuel permet de parler d’argent hors des tensions du quotidien. On se prépare un thé, une bière, un café, on choisit un cadre détendu et on obtient un espace serein et sécurisé où chacun pourra partager ses dépenses, ses projets et ses inquiétudes sans crainte d’être jugé(e). Mais surtout, cela permet de ne pas attendre qu’un problème survienne pour enfin parler argent, contrairement à 56 % des couples qui n’évoquent leurs finances qu’en cas de pépin (Fédération bancaire française).
Vous pouvez commencer par détailler vos projets communs positifs avant de passer aux sujets sensibles. Notez les décisions dans un tableau simple ou une appli de budget pour plus de transparence. N’oubliez pas que les mots comptent presque autant que les chiffres. Dire qu’on aimerait vraiment mettre de côté pour les vacances ouvre le dialogue. Initier la discussion par un accablement type là où un « Tu dépenses trop » risque de provoquer quelques tensions. Cette approche, proche de la communication non violente, transforme l’argent en projet partagé et non en arme.
Les discussions financières finiront par se banaliser, loin des carcans habituels de stress et de tabous. Mieux, selon l’American Psychological Association, les couples qui discutent régulièrement d’argent ont 30 % de satisfaction conjugale en plus. Money is the new romance.
Adopter des outils concrets
Le compte joint reste une solution simple et classique, mais des applications de gestion partagée offrent davantage de clarté sans sacrifier l’autonomie. Autonomie et transparence peuvent aller de pair : des tableurs collaboratifs, des applications de suivi budgétaire sont autant d’alternatives souples et modernes.
D’après une étude d’OpinionWay pour Fortuneo, presque 60 % des couples utilisent aujourd’hui un outil numérique pour suivre leurs dépenses. Fini le « Ah, mais tu ne m’avais pas dit que tu avais payé ça » et autres « Garde bien le ticket de caisse. », des solutions digitales vous permettent de :
- Répartir automatiquement les frais selon un ratio choisi (50/50 ou prorata des revenus),
- Visualiser en temps réel les dépenses et l’épargne commune,
- Éviter les malentendus,
- Favoriser une gestion plus équitable et apaisée.
Rendez l’information accessible à chacun sans empiéter sur l’autonomie financière personnelle, ajoutez une pincée de bonne volonté et un zeste de souplesse et vous obtenez un dialogue qui portera ses fruits.
Malheureusement, les outils numériques ne suffisent pas à régler les questions financières si la répartition de l’effort n’est pas clarifiée. Le cœur du sujet reste la manière dont les partenaires choisissent de gérer leurs inégalités de revenus. Ce choix n'est pas neutre : il influence la perception de justice et la qualité de la relation.
Par exemple, le cadre juridique du couple joue un rôle central. Vivre en union libre, se pacser ou se marier n’a pas les mêmes implications financières (et on ne parle pas uniquement du coût du mariage). En concubinage, chacun reste propriétaire de ses biens et revenus. Avec un PACS, il existe un régime de séparation par défaut, sauf choix contraire. Le mariage, lui, impose par défaut le régime de la communauté réduite aux acquêts : les revenus et acquisitions durant l’union appartiennent au couple, sauf clause de séparation de biens.
L’essentiel est donc de combiner trois dimensions :
- Un cadre juridique adapté à la situation du couple,
- Une répartition claire et équitable des contributions,
- Et des outils pratiques qui soutiennent la transparence sans empiéter sur l’autonomie individuelle.
Un trio de choc qui vous aide à dépasser les malentendus, à combiner un cadre clair, une répartition équitable et des outils transparents.
Anticiper les inégalités et protéger chacun
On l’a dit et répété : communication is key. Loin de nous l’idée de nous lancer dans le conseil matrimonial, mais certaines pratiques et réflexes vous permettent de sécuriser votre avenir financier à deux. Aborder dès le départ les écarts de revenus dans le couple permet ainsi d’éviter les tensions, comme dit précédemment, mais aussi de contribuer de façon juste sans créer de dépendance financière.
Des formalités juridiques permettent de sécuriser et protéger le patrimoine commun et éviter les litiges : un PACS ou un contrat de mariage permet de définir un régime matrimonial protecteur (séparation de biens, etc.). Et aussi potentiellement de réduire vos impôts. Une SCI (Société Civile Immobilière) peut également fixer les parts de propriété d’un bien immobilier en fonction des apports réels de chacun.
Enfin, pensez à la transmission ! Sujet peu agréable, on vous l’accorde, mais rédiger un testament, souscrire une assurance-vie avec clause bénéficiaire ou encore effectuer des donations anticipées de son vivant permettent de protéger le partenaire et de préserver les droits de chacun en cas de décès.
Éducation financière et accompagnement
Nous vivons une époque formidable d’un point de vue éducatif : se former sur n’importe quel sujet est plus que jamais accessible. Podcasts, blogs, vidéos, livres... Il y en a pour tous les goûts. On le sait : vous suivez 10 chaînes YouTube d’aménagement d’intérieur et vous avez appris à jardiner avec des podcasts. Alors, pourquoi ne pas vous éduquer ensemble sur vos finances ?
Klemo offre une approche innovante qui vous permet de prendre des décisions sereines à deux, sans avoir des connaissances financières préalables. Avec l’application Klemo, vous pouvez clarifier votre situation financière, visualiser vos revenus, charges, emprunts et investissements et vous projeter ensemble dans le temps. Via une interface intuitive et une IA pédagogique, vous aurez des recommandations concrètes et personnalisées, faciles à appliquer, tout en restant maîtres de vos choix.
Mais Klemo, c’est aussi des contenus pédagogiques et clairs, des conseils et astuces pour votre argent, une newsletter à dévorer pendant votre pause-café. L’argent n’a pas à être anxiogène ou tabou. Ensemble, l’investissement devient plus accessible.
Conclusion
Le tabou de l’argent fragilise la confiance et entretient les inégalités. Mais parler d’argent dans le couple, ce n’est pas être matérialiste : c’est un acte de responsabilité et même d’amour.
Avec Klemo, ce dialogue devient plus simple et plus équilibré. L’application permet de visualiser en temps réel les revenus, les charges et les projets, d’expérimenter différents scénarios et de simuler les impacts de chaque choix. Plutôt que de laisser les inégalités de revenus ou de patrimoine peser sur la relation, Klemo aide à s’organiser avec son partenaire : qui contribue à quoi, comment on répartit équitablement, comment on planifie l’avenir.
C’est une façon de reprendre le pouvoir sur son argent, non pas seul, mais à deux. Klemo ne se limite pas à gérer des chiffres : il favorise l’autonomisation du couple, en transformant l’argent en levier de dialogue, de confiance et de projets partagés. Vous l’aurez compris, un rapport à l’argent sain, c’est avant tout un rapport à l’autre sain.
Sources utilisées
Harris Interactive (2022) – Étude sur les sujets difficiles à aborder en France, dont l’argent et la sexualité
Insee (2022) – Femmes et Hommes : une lente décrue des inégalités
Insee (2023) - Écart de salaire entre femmes et hommes en 2023
Ipsos (2015) – Argent et couple : la confiance ne règne pas !
Yomoni (2024) – Les Français disent-ils toute la vérité sur leurs finances ?
Radio France (2020) : L'argent et le couple, avec Titiou Lecoq | France Inter
Unio Préparation – Gérer l’argent en couple : équilibre, organisation et sérénité financière
Observatoire des Nouvelles – L'arrivée d'un enfant grève le pouvoir d'achat des Français
Amd Conseil (2025) – 60 % des couples disent que l’argent est la première cause de leurs disputes
Boursorama (2024) – Ces 4 règles d’or pour ouvrir un compte joint avec succès
Unio Préparation – La communication non violente : comment en faire un atout pour votre couple
Observatoire des inégalités – Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : état des lieux
Information importante
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et général. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé, financier, juridique ou fiscal.
Elles ne tiennent pas compte de la situation particulière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque lecteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement comporte des risques, y compris un risque de perte en capital.
Pour un accompagnement adapté à vos besoins personnels, nous vous invitons à télécharger l’application KLEMO pour un conseil personnalisé.