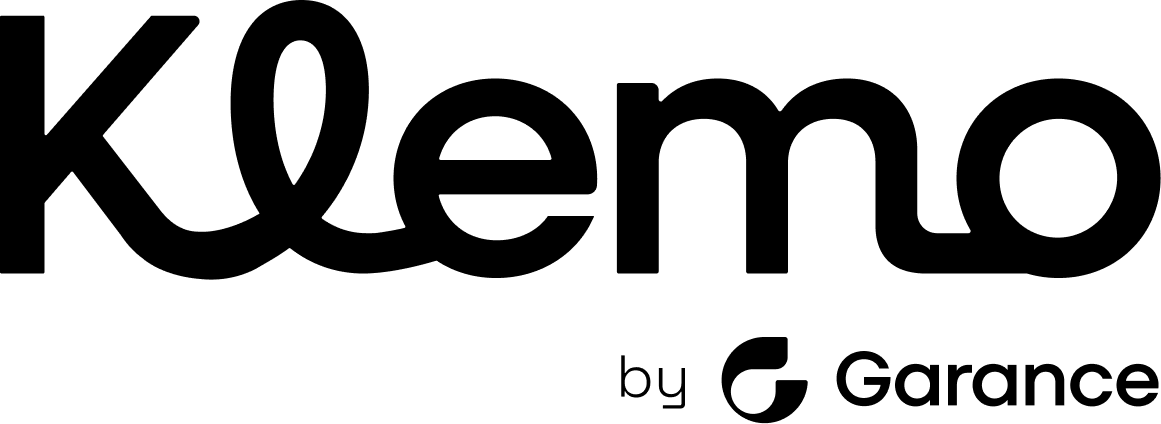Résumer cet article avec :
Le point klé
L’impôt, entre nécessité et ressentiment
Une perception citoyenne négative
En 2024, la France affiche des recettes fiscales nettes de 325,7 milliards d’euros d’après la Cour des Comptes. Les dépenses publiques totales sont estimées à 1 670,2 milliards d’euros, soit 57,1 % du PIB, selon l’Insee.
En parallèle, la France atteint 169,6 milliards d’euros de déficit public, soit 5,8 % du PIB (Insee). Sur le plan européen, l’Hexagone se classe au 2e rang pour son ratio de dépenses publiques, derrière la Finlande (57,6 % du PIB).
Voilà pour le contexte. Rassurez-vous, on ne va pas uniquement parler chiffres (restez avec nous les littéraires !). Il nous semblait utile de mettre en avant ces sommes qui peuvent sembler brouillardeuses, mais qui participent à la perception toujours plus négative du système fiscal français par ses habitants.
Oui, selon plusieurs enquêtes (Ifop, Eurobarometer), 72 % des Français estiment payer trop d’impôts et 63 % jugent que leur argent est mal utilisé. Le pays d’Astérix fait partie des pays européens où la confiance envers la gestion de l’argent public est la plus faible : 28 % des Français pensent que les impôts sont utilisés au bénéfice de tous contre 48 % en moyenne dans l’Union Européenne.
La fatigue fiscale va souvent de pair avec la phobie administrative, deux notions qu’on retrouve facilement dans les discussions entre particuliers ou sur les forums et réseaux sociaux en ligne : pourquoi ai-je l’impression de payer pour rien ? Je n’arrive pas à comprendre où part mon argent ? Autant de questions et de débat qui alimentent la toile et les apéros et qui témoignent d’un décalage entre contribution et perception du service rendu.
L’héritage historique
L’histoire fiscale française est marquée par une méfiance ancienne envers l’État collecteur. Sous l’Ancien Régime, l’impôt (la taille, la gabelle), était uniquement réservé au Tiers État, tandis que la noblesse et le clergé en étaient exemptés. De quoi nourrir un sentiment d’injustice durable.
Vient ensuite la Révolution française de 1789 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dont l’article 13 stipule que “pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.”
Cette idée d’égalité devant l’impôt reste encore aujourd’hui le fondement moral de la fiscalité française, mais ce qui fait débat, c’est bien sa mise en œuvre. La fiscalité française moderne s’est construite autour d’un État très centralisé, sans réelle culture de redevabilité locale (à l’inverse, par exemple, des pays nordiques, où les impôts sont souvent perçus et gérés localement). Résultat, on note une distance entre les contribuables et les dépenses publiques.
Une spécificité culturelle française
L’impôt est un symbole de solidarité, mais aussi un marqueur de l’interventionnisme étatique. Culturellement, les Français n’aiment pas parler d’argent, de fiscalité et encore moins d’impôts. Ces notions peuvent même être taboues, à l’inverse des foyers anglo-saxons chez qui l’argent est un sujet éducatif comme les autres.
Ce qui en découle, c’est que les Français ont l’habitude d’avoir un État qui intervient dans tous les aspects de leur gestion financière. La France a le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé d’Europe (42,8 % du PIB en 2024, Insee), mais aussi l’un des systèmes les plus redistributifs. L’OCDE indique que cette redistribution réduit les inégalités de revenus en France de près de 40 %, contre 30 % en moyenne dans les autres États membres.
C’est donc un système efficace à première vue, qui participe à la légitimité morale de l’impôt, mais pas nécessairement à son acceptation psychologique.
Un débat de société permanent
L’imposition, en voilà un sujet houleux en France. Certains libéraux voient l’impôt comme une entrave à la liberté individuelle (“l’impôt, c’est le prix de la servitude” comme l’annonçait Frédéric Bastiat, économiste, homme politique et magistrat français ). D’autres ont une approche républicaine voire keynésienne en acceptant l’impôt comme prix de la civilisation.
Finalement, c’est la transparence qui joue le rôle le plus important : les citoyens en réclament toujours plus. Comment visualiser clairement les dépenses financées ? Comment s’y retrouver dans les différents graphiques et simulateurs disponibles en ligne ?
C’est un débat social qui enflamme les Français depuis des lustres. Les fatigués fiscaux saturent, surtout dans les classes moyennes qui déclament n’être pas assez riches pour défiscaliser, ni assez pauvres pour être aidées. De leur côté, les solidaristes rappellent que l’impôt finance hôpitaux, écoles et infrastructures : des biens collectifs essentiels, mais dont on s’occupe rarement à leur juste valeur.
En bref
On entend tout et son contraire sur l’impôt en France : c’est une promesse comme une fracture. Promesse d’un modèle social protecteur et fracture d’un contrat social qu’on perçoit comme rompu. Le but, c’est de comprendre sa mécanique et ses finalités. Pour pouvoir jouer correctement au jeu, il faut comprendre ses cartes.
La composante émotionnelle des impôts
Le sujet des impôts est évidemment émotionnel : il touche à la valeur du mérite, à la transparence de l’État et à une question de confiance collective.
Vient en premier lieu la peur de l’injustice. La peur de payer pour les autres étreint bon nombre de citoyens, alimentant de fait un sentiment de déséquilibre social. La redistribution est perçue comme opaque et la dette augmente en parallèle de prélèvements records.
En matière de finances, les biais psychologiques jouent un rôle prépondérant. L’aversion à la perte conduit les contribuables à ressentir plus fortement la perte (symbolisée par l’impôt) que le bénéfice (à savoir le service public). Même son de cloche du côté du biais d’injustice dont on parlait juste avant : on peut avoir le sentiment d’être le seul à payer, surtout chez les indépendants et les jeunes actifs qui débutent leur carrière et découvrent les joies de l’impôt sur le revenu.
La fracture politique et sociale que connaît le pays depuis plusieurs années n’aide pas. La réactance fiscale devient plus vivace, avec des hausses perçues comme arbitraires (taxes sur les carburants, sur les billets d’avion, sur le foncier...). Ce qui conduit à une résistance plus vive.
Relation de confiance : mais où vont mes impôts ?
Qui n’a jamais prononcé cette phrase ou entendu quelque part ? Pourtant, la question n’est pas si rocambolesque. On paye, on paye, mais pour quoi au juste ? Dans cette partie, analysons la répartition des dépenses publiques. Attention, on va parler chiffres (mais pas trop, promis).
Recettes fiscales
En 2024, les recettes fiscales nettes atteignaient 326 milliards d’euros en France. Dans le détail, la répartition est, comme chaque année, dominée par nulle autre que la Taxe sur la Valeur Ajoutée aka la TVA :
- TVA : 97 milliards d’euros - 28 % des recettes
- Impôt sur le revenu : 89 milliards d’euros - 26 % des recettes
- Impôt sur les sociétés : 60 milliards d’euros - 17 % des recettes
- Droits d’enregistrement, timbres, contributions et taxes indirectes : 38 milliards d’euros - 11 % des recettes
- Autres produits de nature fiscale et assimilés : 32 milliards d’euros - 9,3 % des recettes
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques : 16 milliards d’euros - 4,6 % des recettes
- Amendes, prélèvements divers et autres pénalités : 13 milliards d’euros - 3,7 % des recettes
.
Source : Statista.
On note ainsi que la TVA, l’IR et l’IS représentent 72 % des recettes fiscales en France.
Les dépenses de l’État
On sait ce que la France perçoit, maintenant intéressons-nous à ce qu’elle dépense. Et des dépenses, elle en a un paquet. L’ensemble atteint 1 670 milliards d’euros en 2024, ce qui représente 57 % du PIB du pays. C’est aussi une hausse de 62,8 milliards par rapport à l’année précédente (2023).
Ce qui devait arriver arriva : la dette publique de l’État s’envole pour atteindre un pic à la fin du deuxième trimestre 2025 de 3 416,3 milliards d’euros... soit 115,6 % du PIB. Pour vous donner une idée, la dette a augmenté de 780 milliards depuis 2019 et de 1 075 milliards en dix ans. Oui, le bateau prend l’eau.
Pour se comparer à nos voisins, la France est deuxième en termes de dépenses publiques en pourcentage du PIB derrière la Finlande. Viennent ensuite l’Allemagne, l’Italie puis l’Espagne. Dans l’UE, la moyenne est de 49,2 % du PIB pour les dépenses publiques.
Vous voyez le topo, la France dépense plus que vous en période de soldes, mais on peut alors se questionner : comment un tel niveau de frais ne produit-il pas de meilleurs résultats ? Du moins, c’est ce que de nombreux Français se demandent. La productivité des services publics est aujourd’hui au cœur des discussions économiques. L’Hexagone continue de multiplier les hausses budgétaires alors que d’autres pays avancent avec leur temps. On pense par exemple à l’Estonie et son programme e-Estonia qui est parvenue à dématérialiser plus de 99 % des démarches administratives. Tout en réduisant leurs coûts de fonctionnement. Tant qu’à faire.
Alors quoi ? La France serait-elle dans le déni ? Sans réelle culture du résultat, l’Etat restera shooté à la dette, pour reprendre l’expression de plusieurs économistes, alimentant alors le déni collectif. Ajoutez-y une pincée de mesures conjoncturelles (primes, aides et autres dispositifs temporaires) qui tiennent généralement plus de l’émotion médiatique plutôt que de la stratégie à long terme. Vous obtiendrez un système opaque et illisible, où des piles de lois fiscales tanguent aux côtés de niches sectorielles incompréhensibles.
À retenir
Le système Français tel qu’il est actuellement se révèle toujours plus illisible, coûteux et inefficace sur certains aspects. Plutôt que de reconnaître le manque d’évaluation et de priorisation des dépenses publiques, l’Etat préfère s’enfoncer toujours plus loin dans son déni... et dans nos impôts.
Que financent mes impôts ?
OK, on a planté le décor. Maintenant, passons à la question qui nous intéresse tant : je paye mes impôts, mais qu’en fait l’État ? Voici, en pourcentage, en moyenne, ce que financent vos impôts aujourd’hui (source : données de 2023, Insee).
- Retraites : 25 %
- Santé : 20 %
- Education : 8,8 %
- Fonctionnement des administrations publiques : 6,6 %
- Soutien aux activités économiques : 5,9 %
- Transports et équipements collectifs : 5 %
- Famille : 4 %
- Charge de la dette : 3,1 %
- Défense : 3,1 %
- Recherche : 3 %
- Chômage : 2,9 %
- Culture et loisirs : 2,6 %
- Sécurité : 2,5 %
- Autre solidarité : 2,5 %
- Environnement : 1,7 %
- Aides au logement : 1,3 %
- Infrastructures : 1,1 %
- Justice : 0,5 %
Si on lit entre les lignes, on constate que la retraite et la santé forment ensemble près de 45 % des dépenses publiques. Un intérêt particulier pour l’Etat de miser dessus ? Pas vraiment, c’est plutôt la conséquence d’un vieillissement démographique structurel. On vit tout simplement plus longtemps : la part des Français âgés de plus de 65 ans est de 20,5 % aujourd’hui, contre 15,7 % il y a vingt ans.
De quoi expliquer le Big Bang du déficit public ? Oui, en partie. Une étude récente de la fondation IFRAP nous éclaire quant aux déficits liés aux retraites : ils représentaient 2,1 % du PIB par an en moyenne entre 2002 et 2023, ce qui représente 47 % du déficit total des administrations publiques sur la même période. Edifiant.
Pour la faire simple, si le déficit explose, c’est que près de la moitié de cet accroissement est dû aux coûts automatiques liés à la retraite et la santé. Et non par des choix de dépenses discrétionnaires, par exemple. Mais alors, pour réduire la dette, faut-il réduire ces dépenses ? Si oui, au détriment de la solidarité intergénérationnelle ou de l’accès aux soins ? Oui, nous faisons désormais face à un débat qu’il faut prendre en considération...
De l’émotion aux comportements fiscaux
Avec tout ça en tête, on comprend facilement que la perception négative des impôts pour une partie des citoyens influence directement leurs comportements. Une étude Ifop va jusqu’à afficher que 60 % des Français déclarent chercher activement à réduire leurs impôts ou à optimiser leur fiscalité.
Mais le système fiscal n’a pas fini de nous étonner : sa complexité s’étend aux niches fiscales, au nombre de plus de 470 ! D’après la Cour des comptes, ces niches représentent environ 80 milliards d’euros de manque à gagner annuel. Bien évidemment, ces avantages fiscaux sont des dispositifs légaux, mis en place par les gouvernements successifs afin de soutenir financièrement certains secteurs ou zones géographiques en besoin. On ne parle pas ici d’évasion fiscale.
De quoi créer un sentiment de confusion, voire d’iniquité : comprendre le système permet de le contourner, subir le système fait qu’on se sent piégé. Cette fatigue fiscale conduit les Français à développer plusieurs types de comportements :
- Certains se tournent vers l’optimisation légale (via des placements sur un PER ou via l’immobilier).
- Certains optent pour l’évitement partiel illégale (non-déclaration d’activité secondaire, revenus auto-entrepreneurs).
- D’autres pratiquent l’évasion ou l’exil fiscal de manière illégale : un manque à gagner pour l’État estimé à environ 80 milliards d’euros (Statista).
Cette volonté de réduire ses impôts vient en parallèle d’un niveau de confiance dans les institutions publiques en baisse drastique. Ainsi, l’Eurobaromètre 2023 nous dévoilait que 33 % des Français avaient encore confiance dans ces dernières, contre 52 % en moyenne dans l’UE. On tient là un moteur majeur de défiance fiscale : plus on doute de la bonne utilisation des recettes, plus on a envie de passer son tour.
Le civisme fiscal dépend principalement de la perception d’équité et non du niveau d’imposition réel. Autrement dit, un contribuable acceptera plus facilement un impôt élevé s’il juge la dépense utile, transparente et équitable.
Enfin, impossible de passer outre la phobie administrative et fiscale : le stress émotionnel face à la bureaucratie et au risque d’erreur bride bon nombre de Français cherchant à alléger la pression fiscale. Ne rien comprendre à sa déclaration de revenus, craindre de se tromper ou encore s’empêcher d’appeler impots.gouv.fr de peur d’avoir une crise de panique sont autant de situations qui parsèment le quotidien de nombreux contribuables.
Le saviez-vous ?
L’impôt sur le revenu n’est payé que par 45 % des foyers français, soit 19 millions.
Environ 0,2 % des foyers fiscaux les plus aisés représentaient plus de 40 % de l’impôt sur le revenu collecté en 2022.
Sortir de l’allergie fiscale : entre inertie et pédagogie
On l’a vu, malgré son taux de prélèvements obligatoires record, la France n’a pas encore mené de réforme fiscale d’ampleur. Et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation politique du pays ne semble pas aller en la faveur d’un retournement de situation rapide. L’État prélève toujours plus et la dette augmente toujours plus.
C’est une situation qui nourrit une spirale de méfiance : les citoyens doutent de l’efficacité de la dépense publique, l’État continue d’augmenter la fiscalité, les contribuables cherchent à s’en protéger et ainsi de suite.
Pour mettre fin à ce mythe de Sisyphe fiscal, pédagogie et transparence sont de rigueur. En France, l’éducation financière reste marginale : selon l’OCDE, seuls 25 % des Français estiment comprendre les principes de base de la fiscalité, contre 51 % au Royaume-Uni, par exemple). Chaque citoyen gagnerait alors à s’éduquer financièrement sur des sujets que beaucoup voient comme ennuyeuses au mieux, horripilantes au pire. Pourtant, sans comprendre les mécanismes de la fiscalité de son pays, on peut se bercer de faux-semblants et d’idées reçues.
Tout n’est pas noir : des initiatives locales et numériques émergent : des simulateurs en ligne, la mise en lumière du budget citoyen par le gouvernement ou encore certains médias ou entreprises qui cherchent à vulgariser la fiscalité pour la rendre accessible à tous. Renforcer la transparence et la compréhension du système, c’est l’une des clés pour réduire cette allergie fiscale et restaurer un contrat social fiscal fondé sur la confiance, et non sur la contrainte. Et ça, c’est un travail à la fois pour l’État et pour vous.
Conclusion
Et vous, de votre côté, que faire ? À votre échelle, on ne peut que vous conseiller de vous former : avec une meilleure compréhension des dispositifs de réduction d’impôt, du fonctionnement de la fiscalité en France ou encore des démarches administratives encore obscures, vous aurez les cartes en main pour mieux gérer votre argent. Le seul problème sera de lire le Bofip sans vous endormir.
Et pour ça, Klemo peut vous aider en vous mettant à disposition des guides complets pour mieux comprendre impôts et fiscalité, et surtout une application spécialement pensée pour vous. Oui, vous qui n’avez ni le temps ni l’envie de vous consacrer aux problématiques financières. En quelques clics, obtenez un bilan financier gratuit et des pistes d’investissements adaptées à votre profil qui prennent en compte l’impact de vos impôts sur l’année en cours dans ses calculs. Sans blabla ni jargon. On laisse ça au fisc.
Information importante
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et général. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé, financier, juridique ou fiscal.
Elles ne tiennent pas compte de la situation particulière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque lecteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement comporte des risques, y compris un risque de perte en capital.
Pour un accompagnement adapté à vos besoins personnels, nous vous invitons à télécharger l’application KLEMO pour un conseil personnalisé.
Beaucoup de Français ne sont pas fiers de payer des impôts pour plusieurs raisons : manque de confiance dans l’État, honte d’avoir un revenu conséquent ou encore ressentiment face à la perte d’argent.
On compatit. Le système fiscal français est complexe et beaucoup ressentent du stress à l’idée de mal faire. Commencez par vous créer un espace personnel sur impots.gouv.fr sur lequel vous trouverez bon plusieurs explications simples et FAQ. En cas de doute, contactez votre centre des finances publiques. Enfin, respirez un grand coup : mieux vaut finaliser vos démarches au plus vite que de laisser traîner !
La lassitude fiscale est très répandue en France, pourtant plusieurs options s’offrent à vous pour réduire vos impôts : vérifiez que votre taux d’imposition est à jour sur votre espace personnel impots.gouv.fr, faites des dons à des associations (jusqu’à 75 % de réduction d’impôt), épargnez sur un Plan Épargne Retraite (versements déductibles de votre revenu imposable) ou misez sur l’immobilier locatif.

Written by Wilhelm Bertieux
Rédacteur plurimédia passionné par la finance, je mets les mots au service de vos euros. Mon credo ? Vulgariser sans jamais ennuyer, pour rendre les finances personnelles accessibles à tous — même à ceux qui pensaient détester ça. Parce que bien ...